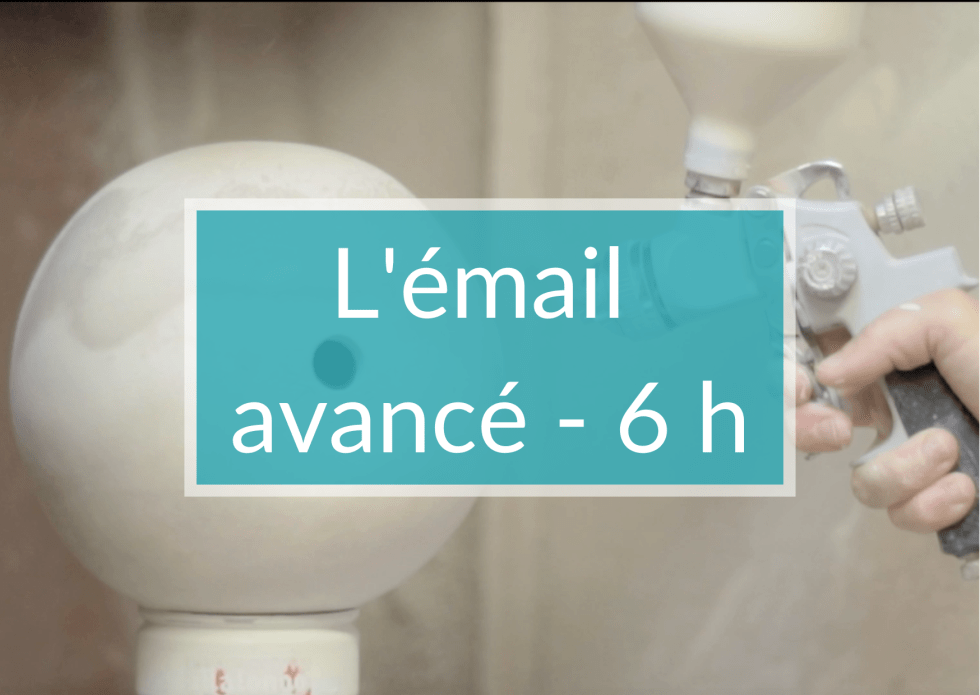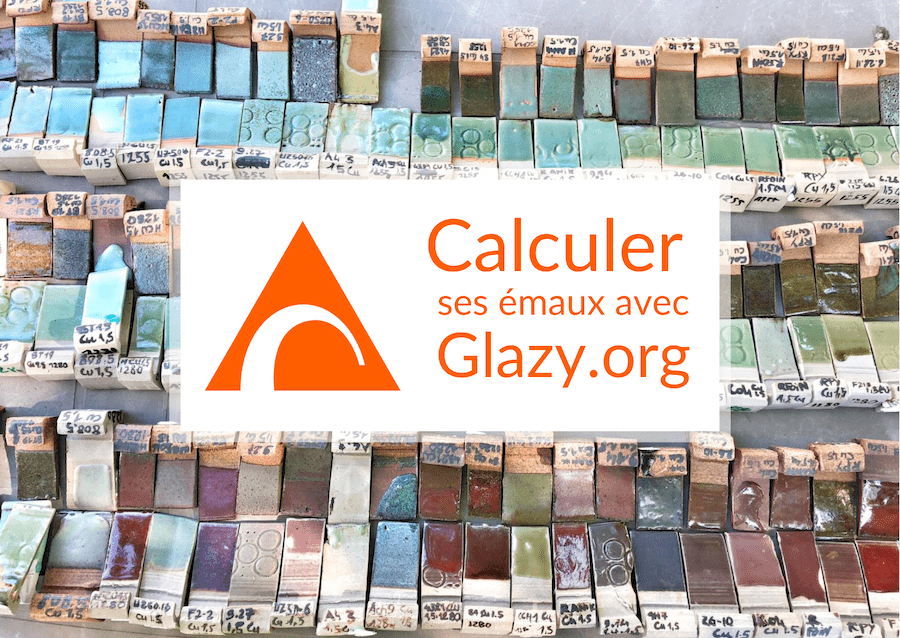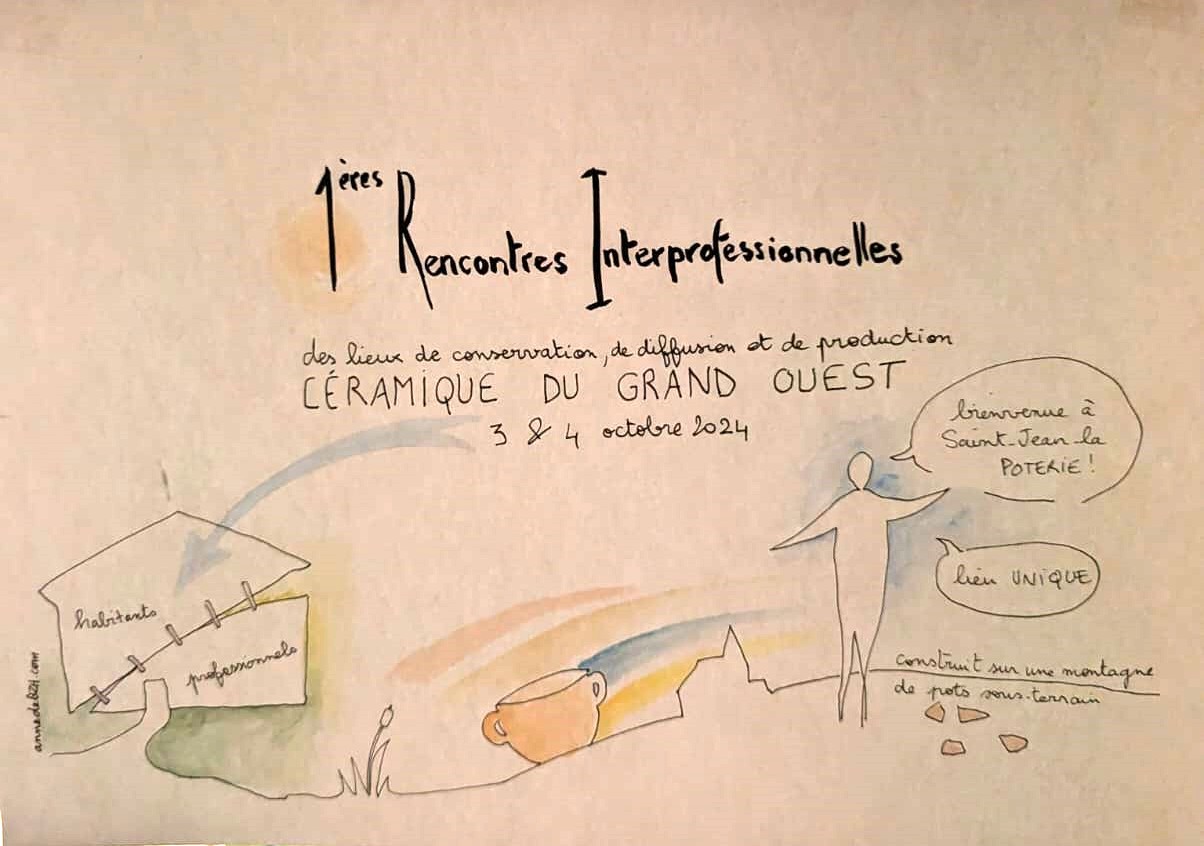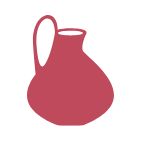À la découverte de l’art des potiers japonais
1. S’inspirer de la culture céramique japonaise
2. Rencontres avec les grands maîtres potiers japonais
3. Les conseils pratiques des céramistes japonais
4. La quête initiatique du potier
Lorsqu’on est céramiste, il arrive toujours un moment où l’on ressent presque irrésistiblement l’appel du Japon. Écrivain, philosophe et potier, Jean Tessier illustre ce sentiment dès le prologue de son roman Le Japon des potiers par cette phrase qui résonne comme une maxime : « Le Japon pour le potier, c’est Vienne pour le musicien ! ».
Partez à la découverte de l’essence de la céramique au Japon, véritable art empreint de spiritualité, grâce à la plume de Jean Tessier.
S’inspirer de la culture céramique japonaise
Né en 1931, Jean Tessier a profondément marqué la céramique du XXe siècle. Avec ce roman publié en 1993, il s’appuie sur ses propres voyages pour raconter la mission ambitieuse qu’il s’est donnée : faire naître en France une véritable culture céramique, nourrie par la sagesse et l’expérience d’artistes japonais, qui cultivent leur art comme une pratique spirituelle autant que technique.
Le livre s’ouvre sur une question radicale : « Peut-on mourir de beauté ? ». Phrase que note Johann, protagoniste et alter ego de Jean Tessier, à bord de l’avion qui l’emmène vers le Japon. Johann arrive au Japon chargé de recommandations et animé par une soif irrépressible de rencontres avec les grands maîtres du pays.
Rencontres avec les grands maîtres potiers japonais
Sa première étape est Mashiko où réside Shoji Hamada, l’un des maîtres potiers les plus influents du XXe siècle. Shoji Hamada, Trésor national vivant du Japon (désigné par le Ministère de l’éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie), est une figure centrale du mouvement Mingei qui valorise l’art populaire et les traditions artisanales.
Ici commence véritablement ce pèlerinage artistique et initiatique dont le livre entier est imprégné. À Mashiko, Johann fait l’expérience d’une hospitalité hors du commun. En ce lieu, il découvre une philosophie où l’objet façonné à la main, loin d’être seulement utilitaire, devient vivant et porteur d’une identité culturelle forte.
Jean Tessier souligne également à quel point les potiers japonais se définissent par rapport à leurs fours. Les ateliers sont souvent désignés par ces derniers comme les cœurs battants des communautés potières. La cuisson y est un rituel où l’artiste confie son œuvre à l’alchimie mystérieuse du feu.
Le voyage se poursuit par la visite d’autres lieux emblématiques. A Kyoto, Johann découvre une ville où la céramique est étroitement liée à la spiritualité et à l’artisanat quotidien. Il visite la maison de Kanjiro Kawaï, autre figure majeure du mouvement Mingei, où chaque poterie raconte une histoire, celle d’un morceau d’âme capturé dans la matière. Cette immersion lui permet de comprendre une vérité essentielle énoncée par Yu Fujiwara, maître potier qu’il visitera ensuite à Bizen : « La terre est l’élément le plus important en poterie. Cherche inlassablement celle qui correspond à ta nature profonde ».
À travers cette quête de terre idéale, Johann prend conscience d’une différence fondamentale entre la pensée occidentale et la philosophie japonaise. Ici, la terre précède le feu et la forme. Au lieu d’imposer la pensée à la matière, comme en Occident, le potier japonais écoute la terre, respecte son rythme et ses déterminations.
Autre différence radicale entre l’Orient et l’Occident, celle de la distinction entre artisanat et art qui en Occident se fait par l’utilité que revêt un objet. Jean Tessier nous apprend qu’au Japon, la distinction s’opère plutôt entre « art » et « objets de luxe », car ce qui sort de la main de l’homme est de l’art : « l’objet d’art, c’est-à-dire l’objet fabriqué de la main d’un artiste ou d’un artisan représentait au Japon une valeur supérieure à celle de la notion d’objet de luxe, qui n’est souvent que la forme limite de la pacotille, car jamais un objet d’art ne sortira d’une usine. »
Les conseils pratiques des céramistes japonais
Si le roman de Jean Tessier témoigne de la force de la pensée philosophique japonaise, il n’est pas exempt de conseils concrets, ce qui rend le livre doublement utile au potier qui le lit.
Yu Fujuwara, notamment, délivre un conseil fondamental à celui qu’il considère comme un apprenti : « Un pot doit être monté à la main, en laissant le moins de traces possible. Quand tu coupes la base pour le retirer du tour, ne pousse pas ton fil vers l’extérieur : tu perdrais tes forces vitales ; ramène-le plutôt vers toi pour rassembler ton énergie. Un pot ne doit jamais être repris à l’outil au moment du finissage, sinon, pourquoi ne pas le mouler ? Le tournage par lui-même est trop beau pour qu’on l’altère ».
Et Yu Fujuwara de continuer : « Le cylindre, forme apparemment simple, révèle une vérité profonde. On croit que tourner un cylindre est facile, c’est tout le contraire ! La terre ne demande qu’à redescendre, alors qu’avec un ventre, la voûte de terre tient toute seule. La forme d’un cylindre n’est pas a priori aussi décorative qu’un pot rond : il faut plus de génie pour la rendre vivante. Commence toujours ton apprentissage par la réalisation de cylindres parfaits. Les formes arrondies cachent trop aisément les défauts de tournage, alors que le cylindre te dira toujours où tu te trouves ».
Tout au long du livre, le lecteur aborde les étapes d’un véritable apprenti potier, il y apprend entre autres, à tourner à la motte, à creuser un pied avec un morceau de bambou, à connaître un four anagama…
Les chapitres sur l’apprentissage de Johann dans l’atelier de Yu Fujuwara auprès des apprentis du maître, sont particulièrement instructifs : lavage de sol, préparation de l’argile, répétition obsessionnelle des gestes : tout est ritualisé en une exigence fondamentale : « Le pire qui puisse arriver à la poterie, c’est qu’elle soit exercée par quelqu’un qui n’en soit pas digne » explique le maître. L’atelier devient un monastère où la rigueur n’a qu’un but : atteindre la liberté dans la création.
Le lecteur est tenu en haleine, car le récit des cuissons apparaît tardivement dans le récit. La grande cuisson, décrite comme une cérémonie de onze jours, symbolise l’aboutissement d’une quête spirituelle autant qu’artistique : « Pour moi, l’idée de cuisson et celle de prière sont liées » confie le potier. Les cendres, le hasard contrôlé, les pièces imparfaites, tout rappelle que la beauté naît de l’alliance entre contrôle et lâcher-prise.
Le wabi-sabi, cet art de l’imperfection sublime, devient une métaphore de vie pour Johann, et Jean Tessier nous en donne la clef : « Cherche la perfection de ta nature, mais laisse la faille qui est en toi transparaître. C’est elle qui fait ton charme et celui de tes pots ».
La quête initiatique du potier
Par le truchement du voyage de Johann, Le Japon des potiers est un plaidoyer pour l’artisanat en général. Jean Tessier dresse un constat sévère sur l’Occident : la céramique y est souvent réduite à un « art mineur », écrasée par une industrialisation et le mépris des métiers manuels. Au Japon, même dans une société hyper-technologique, l’artisanat reste un pilier culturel et les potiers apparaissent ici comme les gardiens d’une tradition ancienne, mais aussi des innovateurs inspirés : « l’objet féconde son créateur », rappelle-t-il : ainsi un bol n’est pas un produit, mais l’expression directe de l’âme de celui qui l’a façonné.
La question énigmatique qui ouvre le livre, « Peut-on mourir de beauté ? » n’est jamais directement résolue par Johann. Mais peut-être cette interrogation était-elle adressée à nous, lecteurs et potiers ? Sommes-nous prêts à nous laisser transformer profondément par la beauté, au point d’y consacrer toute notre existence ? Ce voyage, vécu par Johann comme un véritable parcours initiatique, devient aussi le nôtre. Jean Tessier, à travers ce double littéraire, nous invite à une exploration intime de notre pratique, à remettre en question notre rapport à l’art et à la matière.
Le Japon des potiers nous offre ainsi la possibilité d’une quête intérieure, une occasion rare de redécouvrir ce qui fait de nous des artisans et des artistes. Jean Tessier n’a finalement jamais quitté ce Japon mythique qui nourrit tant de céramistes. Et grâce à lui, nous non plus.

Centre de ressources
animé par Matthieu Liévois,
potier-céramiste depuis plus de 40 ans et fondateur de l’école Créamik
Retrouvez tous les cours
Mots clés
Ne ratez plus les nouveautés de l’école Créamik !